Maintenant, je suis là, rouge au soleil, les yeux fermés.
Longtemps, il s’est agi d’avoir les yeux grands ouverts. Cette injonction d’Albert Camus m’avait paru essentielle, je la suivais scrupuleusement, une philosophie toute entière du regard sur la vie.
Mais, j’avoue, désormais je ferme souvent les yeux, sinon c’est insupportable, Pardon Camus, on regarde comme on peut, parfois beaucoup, certains décrivent ce qu’ils voient pour ceux qui voient moins bien, mais on ferme les yeux, plusieurs fois par jour, parfois des jours entiers.
Parce qu’il y a cette question qui revient quand on garde les yeux ouverts : On fait quoi ? Et comme on ne sait pas bien y répondre, on referme les yeux.
Devant les paysages, je prends le plaisir pour lequel je me suis entraînée. Je crois que cela me sert, que cela me construit, me renforce. Mon corps en tremble de plaisir quelquefois. Mais même au sujet des paysages, je ne suis plus sûre de rien. J’ai de la chance de les voir, malgré les malheurs, on en a tous nos doses, nos épreuves minuscules et lourdes à la fois, mais je vois encore et de plaisir je tremble. J’ai de la chance…
J’ai remarqué, à force, ça fait se taire. Pour celles et ceux qui écrivent, qui peignent le monde, qui montrent, qui pensaient que leur métier c’était de raconter, il y a une tentation du silence. Terrible. Terrible qu’on en viendrait tous à se taire.
Là, par exemple, j’hésite avec ce texte. Je me dis, ça va saouler, les gens en ont marre, toujours le même motif, l’obsession, c’est triste, on veut penser à autre chose, on en a marre du monde qui va mal, pour ce que ça change en plus, là c’est l’été, les vacances, on prend des forces pour la rentrée, pas encore des textes tristes sur les tragédies.
C’est drôle cette histoire de regard, que ça me paraisse si essentiel, parce que mes deux parents, l’un après l’autre, ont des maladies avec des problèmes de vue. Mon père devenait aveugle à cause du diabète. Ma mère ne voit plus que selon un zoom à hauteur d’yeux, qui va en se rétrécissant, avec des éblouissements, alors elle passe la plupart de son temps dans la pénombre, à ne rien regarder, et « c’est là qu’elle est le mieux » me dit-elle.
Pour une idée de livre à écrire (un projet), j’ai traversé un pays devenu très riche. Mon guide, c’était une femme écrivaine qui avait vingt ans en 1839. Deux cents ans plus tard, un mois de juillet de jour polaire aussi, les yeux brûlés de lumière, je me suis assise en haut d’une falaise et j’ai regardé comme elle, le port d’Hammerfest et les îles-montagnes en face. Je suis allée voir la cascade furieuse qu’elle décrit et j’ai bien trouvé « les rochers noirs ronds comme des dos de bête », et l’eau désormais toute en retenue était depuis devenue utile alimentant une centrale électrique…
C’était un curieux voyage, un repérage, une traversée accélérée avec des pauses contemplatives pendant une journée polaire qui a duré 10 jours, à prendre des notes au fil de la route, comprendre aussi comment elle avait écrit son propre voyage, découvrir ce qu’elle inventa un peu…
Dans le pays riche et sa nature bouleversante, malgré l’émotion que cela donne, j’ai toujours vu les deux mondes. Il y avait cette gare de Narvik, dans le Nord de la Norvège, ces jeunes hommes noirs, que j’imaginais aller à Kiruna, la ville minière suédoise où tous les jeunes suédois veulent travailler parce qu’ils ont des bons salaires, la ville qui s’effondre à cause du sous-sol creusé et qui est reconstruite à l’identique plus loin (Maylis de Kerangal le raconte dans Kiruna, j’avais lu son livre dans l’hiver après qu’elle soit venue à la Machine à Lire, et je ne savais pas encore que je passerai par la gare de Kiruna en juillet). Et donc, j’allais monter dans un train depuis la gare de Narvik en Norvège pour rentrer vers le Sud et traverser la Suède et ce train passait par Kiruna, et ces jeunes hommes noirs qu’on remarquait forcément au milieu de nous tous touristes blancs, ils avaient les mains dans la poche, ils étaient sans bagage, ils se connaissaient, on voyait qu’ils avaient l’habitude d’être là, et je les imaginais aller travailler à Kiruna et je me disais « Ils font sans doute ce trajet plusieurs fois par semaine, mais au moins ils gagnent de l’argent » comme je l’avais lu dans le livre, les gros salaires des employés de la mine de fer pour les motiver. Le train est arrivé, les jeunes hommes noirs ont été les seuls à monter au niveau des derniers wagons, nous nous devions attendre encore un peu, la cheffe de gare le disait autoritairement aux voyageurs qui tentaient de monter pressés et c’était cuisant la façon dont elle vous faisait repartir sur le fond du quai, et les jeunes hommes noirs montaient eux dans le train, pour le nettoyer, ils faisaient le ménage, on les voyait marcher à toute vitesse dans les compartiments avec des sacs poubelle, et plus tard le train est revenu sans eux, propre, et nous avons eu le droit de monter.
Les deux mondes, sans arrêt. Comme si je voyais double désormais. Ça doit être un truc de famille ce problème avec les yeux. Moi, c’est en double que je vois. Un monde et l’autre en même temps. La beauté du glacier et toutes les voitures à 400 chevaux ; la magie des dauphins qui traversent le fjord et l’élevage de saumons ; je rêve de voir une baleine et je scrute la mer depuis le ferry et je mange des beignets de poissons cuits au barbecue ; la Norvège qui propose le énième concept – So Kos – et qui fait tout fabriquer en Chine et qui nous invente des histoires comme si la décoration intérieure ne pouvait plus être autrement qu’à leur goût en apparence minimaliste à renouveler sans cesse, etc.
Un dîner, je parle avec Estelle : on ne sauvera pas le monde ce soir. Elle est déçue, peut-être qu’elle comptait sur moi, mais elle persiste alors elle propose en se quittant sur le trottoir : Et si pendant un mois nous ne racontions que ça, que des histoires différentes de celles racontées par les chaines infos et les politiques, si chaque artiste en France ne parle que de ça, ne raconte que ça, ne chante que ça, ne joue que ça, ne danse que ça… Est-ce que tu ne crois pas que ça changerait quelque chose ?
Je la quitte en souriant, je réponds Pourquoi pas peut-être… Son idée me trotte dans la tête depuis.
Chez mon frère, on dîne sous le châtaigner. Il a fait un feu dans le jardin. C’est une très belle soirée. On parle des malheurs, on a des fous rires, on parle des ruines à transformer en maison, des aventures, on parle des objets qu’il entasse, de ceux qui serviront en cas de guerre – des radios CB, une éolienne, des vélos, des ronéotypeuses… – comme autant de trésors. Lui et mon fils s’endorment sous les étoiles au coin du feu. Au petit matin, je les vois dans le jardin enroulés dans leur duvet, les corps à moitié sur les coussins, mes deux hippies je pense, ma seule famille, mes deux amours.
Pour un autre livre, que j’écris depuis quelques mois (en réalité, depuis quelques années), j’ai écouté des gens parler devant l’immeuble abandonné : chaque passant avait son histoire.
Le Signal, de plus en plus vide, en attente de destruction, devient la scène des rumeurs.
Le Signal, au bout du front de mer, comme une promenade sinistre.
Moi, je ne vois plus que la mer à travers ses fenêtres, et je trouve ça d’une poésie folle. Qu’est-ce que je regarde que cette dame à côté de moi ne voit pas ?
Est-ce que si je lui raconte ce que je vois, si je lui avoue que j’y vois double, elle comprendra ?
Voila c’est un été comme ça, de double-vues et d’yeux fermés. Mais c’était la première fois que j’allais dans un pays sans nuit, c’est sûrement ça : j’ai l’œil troublé.


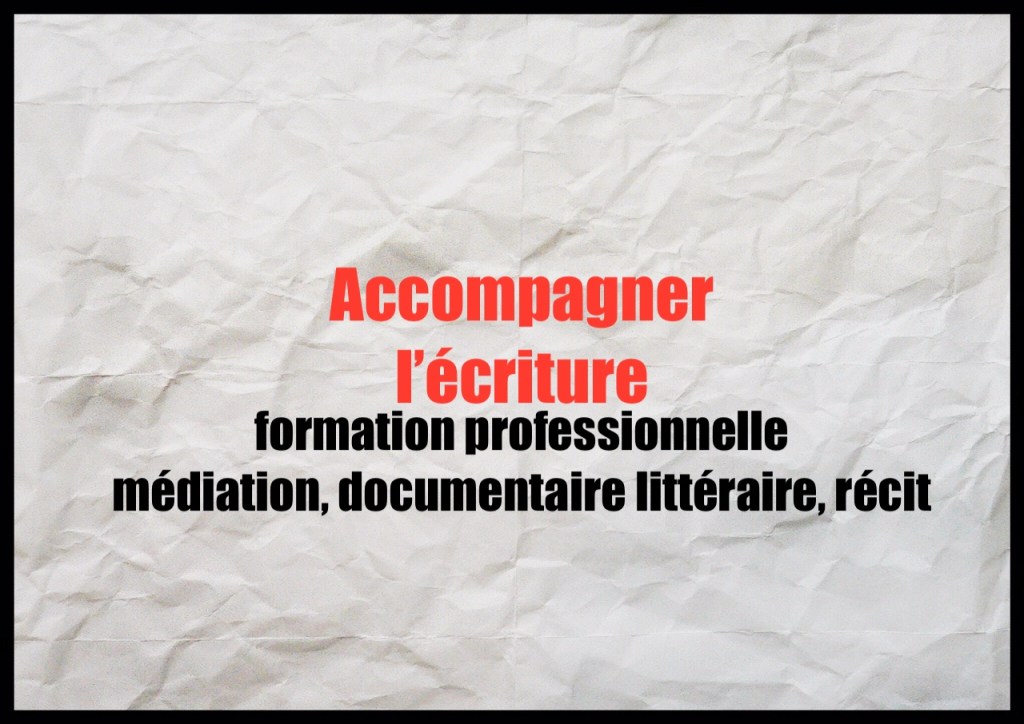

Répondre à Sentimentale (12) – l'expérience du désordre Annuler la réponse.