Il s’en est fallu de peu pour que cette dérive ne s’écrive pas comme l’auteure voulait. Mais heureusement, quand on se perd en route, il y a des gens qui vous aident…
DÉAMBULATION* publiée dans le magazine Junkpage n°6 – octobre 2013
Ça a commencé comme ça.
Dix mille pistes, trente-six choses, pourquoi pas ça, et puis non, ou alors, donc oui je vais aller par là, finalement pas, j’en sais rien je sais pas, ah mais quoi, mais où, ou plutôt oui, non ça une autre fois, et ça sera mieux plus tard, ou pas ! Je n’avais aucune certitude quant à la direction à prendre, je me sentais prise de multiples hésitations, vous savez, quand ça fait cette envie de tout à la fois et qu’on n’arrive pas à faire le choix.
Un peu de frénésie de septembre, mélange d’inquiétudes et de résolutions, vite avalés que nous sommes par la réalité – parce qu’on dit la réalité pour parler du quotidien et tout ce qui ne ressemble pas à des vacances. Dommage.
Et quoi dire ?
Au fond de moi j’avais envie de poésie. Et je l’attendais. Je voulais que ça m’arrive, pas le décider. Je voulais de la surprise. De la beauté aussi. Simple, quelque chose de simple.
En presse écrite, il y a des dates pour rendre les textes. Et la poésie n’arrivait pas. On m’a parlé des ossements dans les fouilles de la place Saint-Michel, alors j’y suis allée. Mais il y avait ces barrières partout à cause des travaux, et j’avais pas envie de lutter ; j’ai senti le climat « campagne électorale » s’installer, je me suis dit : « Tiens, je vais aller voir à la Bourse du travail », là encore travaux. À l’accueil j’ai fait une chouette rencontre, mais j’ai pris RDV pour une autre fois. Il y avait bien des choses à raconter, mais pas tout à fait ce que j’espérais.
La poésie ça ne se commande pas : elle advient ou non.
Plus tard, assise en terrasse, je cherche, tête en l’air. Une bonne dérive, c’est d’abord du désir. Alors, j’attends… Les garçons tatoués aux barbes bien taillées passent, je feuillette le journal. Il y a ce cerveau rose bonbon (un dessin collé) à l’angle de la place Brutus (connue plus tard sous le nom de place du Palais), comme un message qu’on m’adresse : toi tu es là et ton cerveau ici, ce qui ne fait pas un seul homme (femme). Je ne me formalise pas et reste en état de contemplation, continue mon regard-balayage : le journal, les gens, le journal, drôle de look cette fille, le journal, etc.
L’intuition je l’ai eue à cause du titre, Instants éphémères. Mots clés : les mots qui m’allaient.
J’ai laissé passer le vernissage – la poésie s’accommode mal des vernissages – et j’ai attendu le début du dimanche, 13h30, à la Base sous-marine : Sabine Weiss, « Fleeting moments ».
J’ai pris mon vélo.
Ce n’est pas pour raconter tous les détails que je le précise, simplement parce que se rendre à la Base sous-marine sans voiture, ça n’est pas simple. Route sans piste cyclable ou le long des hangars sur du sacré bon gros pavé. Mais j’adore venir jusqu’ici, un peu loin de mes chemins quotidiens, j’aime ce bâtiment intense, chargé de ses tragédies et tourné vers nous à présent, comme il peut. Le ciel est gris. Les habitants de ce port de bric et de broc disent bonjour comme dans les villages. Je passe devant le restaurant L’Huître à flot, fermé, sans rien qui indiquerait pour cause de décès (je l’ai lu dans Sud-Ouest), et je pense à son propriétaire et c’est toujours triste quand un homme n’a plus la force de continuer.
Je me perds dans la forêt des coques de bateaux. Certaines embarcations ressemblent à des maisons bricolées… On vit là, un barbecue encore fumant. Des pirates ? L’épave qui sombre inlassablement à l’entrée du bassin à flot est envahie encore davantage de peluches, sculpture bizarre. Un totem à la gloire de Peter Pan ?
Je ne sais pas ce qui m’attend à l’intérieur de l’exposition, mais la poésie la voilà qui vient : quand les phrases s’écrivent juste parce qu’on regarde, c’est qu’on y est.
J’entre ici.
 Et je tombe amoureuse.
Et je tombe amoureuse.
Dans la pénombre, avec les poursuites sur les images, je découvre. Je m’arrête sur la photographie d’un homme assis en haut d’un arbre, il y a une ville autour. Il a l’air sérieux. Que fait-il là ? Je pense aux cabanes perchées dans lesquelles on peut rêver parfois de se cacher. J’ai oublié de noter l’année, quelque chose qui me dirait à présent un peu du contexte de cette photo… Peut-être une manifestation ? Dans mon souvenir, il a l’air tranquille, pas fuyard, plutôt rêveur.
Je comprends immédiatement que Sabine Weiss est une espiègle. Les premiers accrochages (en triptyque ou face à face) s’amusent : à droite, des hommes – Portugal, 1954 – ont l’air de regarder et de faire sourire sur l’image de gauche deux femmes en costume traditionnel – Hongrie, 1959. Les tirages noir et blanc (argentiques évidemment) ont de beaux formats, pas spectaculaires, à portée d’œil. La musique diffusée amène une fantaisie.
Quelque chose de mon inquiétude, du dehors, du dimanche et de la ville et des soucis, vient de disparaître.
 Ce fumeur qui allume sa cigarette, une rue, la nuit.
Ce fumeur qui allume sa cigarette, une rue, la nuit.
Je pense à Prévert. Et aussitôt, je me demande pourquoi ma représentation de Paris en N&B m’évoque Prévert. À cause de Paroles ? « Comme un homme tranquille au milieu de la nuit », oui, peut-être que c’est ça… Pour rythmer l’exposition, de grands cartels reprennent les réflexions de Sabine Weiss, je note les mots que je préfère. Ils se détachent aujourd’hui sur les pages de mon carnet : « attraper le geste », « fixer le hasard ».
Elle écrit : « Il y avait beaucoup de très beaux brouillards à l’époque, les rues étaient moins chauffées. » Remarque précieuse. Je vais me laisser faire : quelqu’un qui est attentif aux brouillards ne peut pas être mauvais.
Au milieu d’une foule, des hommes debout grimpés sur des chaises, surréalistes silhouettes vues de dos, comme des manifestants, un dessin de Magritte. Il s’agit en fait de spectateurs qui cherchent à prendre de la hauteur pour ne rien rater d’une course de chevaux. Hippodrome d’Auteuil,1952.
 Qu’elle photographie les vieux, les enfants ou les solitudes, je suis surprise de la simplicité avec laquelle elle parvient à montrer l’universel. De Nous et de Eux.
Qu’elle photographie les vieux, les enfants ou les solitudes, je suis surprise de la simplicité avec laquelle elle parvient à montrer l’universel. De Nous et de Eux.
Le scénographe a dessiné une marelle au sol et les petits visiteurs jouent au milieu des enfants photographiés. Ne pas sacraliser. Ici, dans ce musée de la Base sous-marine, les expositions ne se prennent jamais pour autre chose et sont toujours bien faites.
Rome, 1953.
Un petit garçon accompagné de sa mère, dans une église. Il regarde un tombeau sur lequel est peint de façon très réaliste le Christ allongé et ensanglanté (c’est peut-être une sculpture à travers une vitre). L’enfant a sa main dans la bouche, comme s’il se mordait. Je m’attarde. Devant une photographie, il y a quelquefois quelque chose qui frappe de cette façon, comme si on devenait le sujet soi‑même : j’ai l’impression d’avoir 8 ans et de découvrir, devant ce christ effrayant, la mort et le mensonge à la fois.
Dans la dernière pièce.
Des scènes de baisers qui valent autant, sinon davantage, qu’un certain de l’Hôtel de Ville : par exemple celle d’un flirt dans un dancing. Le couple qui s’embrasse se reflète dans une glace (on imagine qu’ils mettent délicieusement la langue pour se rouler une pelle) (devant l’Hôtel de Ville ils s’embrassent juste sur la bouche, c’est évident) (ben oui, c’est quand même très difficile de tourner sa langue dans la bouche de quelqu’un tout en marchant) (essayez, vous verrez).
Et puis je regarde le film sur la dame Weiss.
Elle va parfaitement à son travail. Elle explique, elle rencontre, Vautrin ou Yann Arthus-Bertrand, on voit son mari, et aussi un critique d’art. Et face à ces bonhommes elle a quelque chose de fortiche. Elle rit beaucoup.
Une phrase au vol : « On improvise, on sait un petit peu où on va, on traverse la rue et… »
Elle dit que l’histoire de la photographie raconte l’histoire de la lumière.
Une séquence : elle a RDV dans une rue de Paris. Elle a à la main les planches contact d’une séance photo, ce sont des enfants qui jouent dans cette même rue il y a environ cinquante ans. Deux vieux messieurs arrivent, ce sont eux les enfants. Ils regardent les images, décrivent le passé, la remercient tellement. Tous leurs souvenirs de l’enfance, là, sous leurs yeux, cadeau inespéré. L’un d’eux rapporte : « Quand j’ai montré la photo à mon frère, il a pleuré. » C’est une autre époque, celle où on n’enregistre pas tout à coups de smartphone, celle où les enfants jouent librement dans la rue, et celle où on ne réclamait pas des droits à l’image.
Dans le noir, la salle de projection se remplit. Les visiteurs de l’exposition se serrent, il n’y a plus trop de place, chacun passe un moment avec Sabine. Ma poésie du dimanche après-midi se confirme…
Peut-être que certains n’aimeront pas. Mais rien n’est faux.
On parle de photographie humaniste. Je ne sais pas. On est touché. Et c’est autre chose qu’une nostalgie ou qu’une mièvrerie.
Je prends le chemin du retour.
Le long des quais, remplis à présent comme une rue Sainte-Catherine, j’aperçois des instants fugaces : trois Japonaises avec des grands chapeaux et un caméraman qui les suit, la jupe à carreaux d’une dame âgée qui trottine, un pigeon tout blanc au milieu du sol gris, le père qui court après la petite fille à vélo, les couettes à fleurs sur les lits qu’on aperçoit à travers les cabines vitrées du bateau Princesse d’Aquitaine…
Lundi peut venir, même pas peur.
Sabine Weiss, « Instants fugaces », 120 clichés noir et blanc (pris entre 1946 et 2009), jusqu’au 13 octobre, Base sous-marine, Bordeaux.

Autre texte écrit ici sur la Base sous-marine : Le gris du rêve




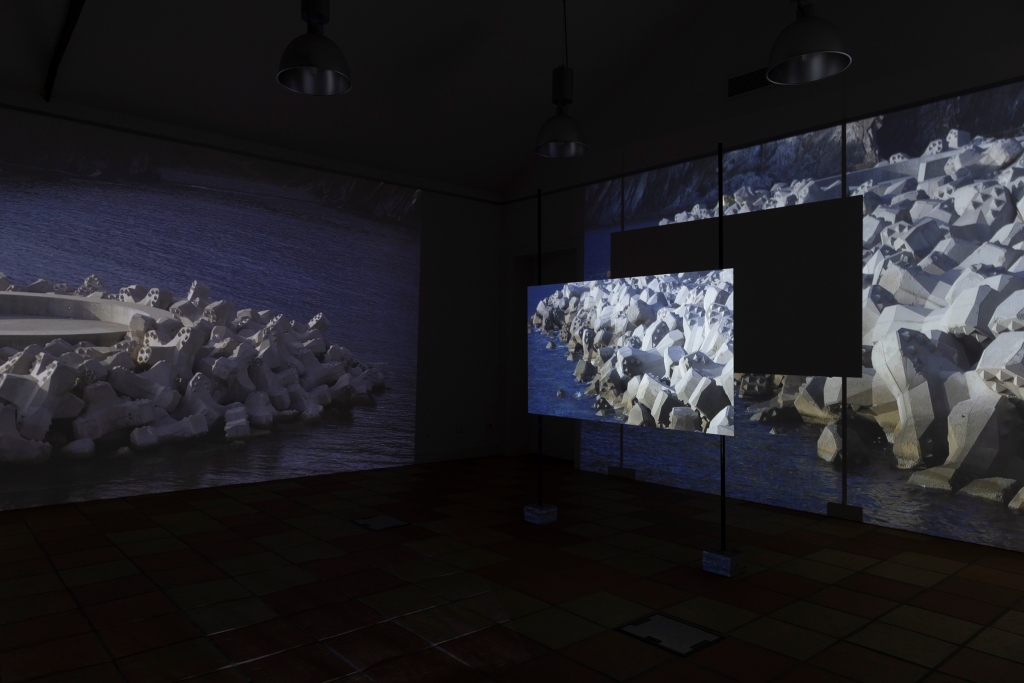

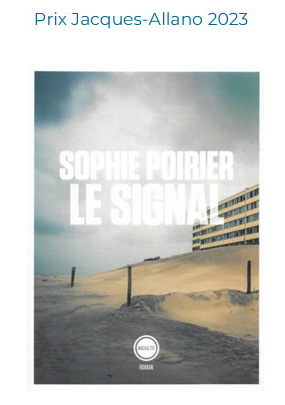
Laisser un commentaire